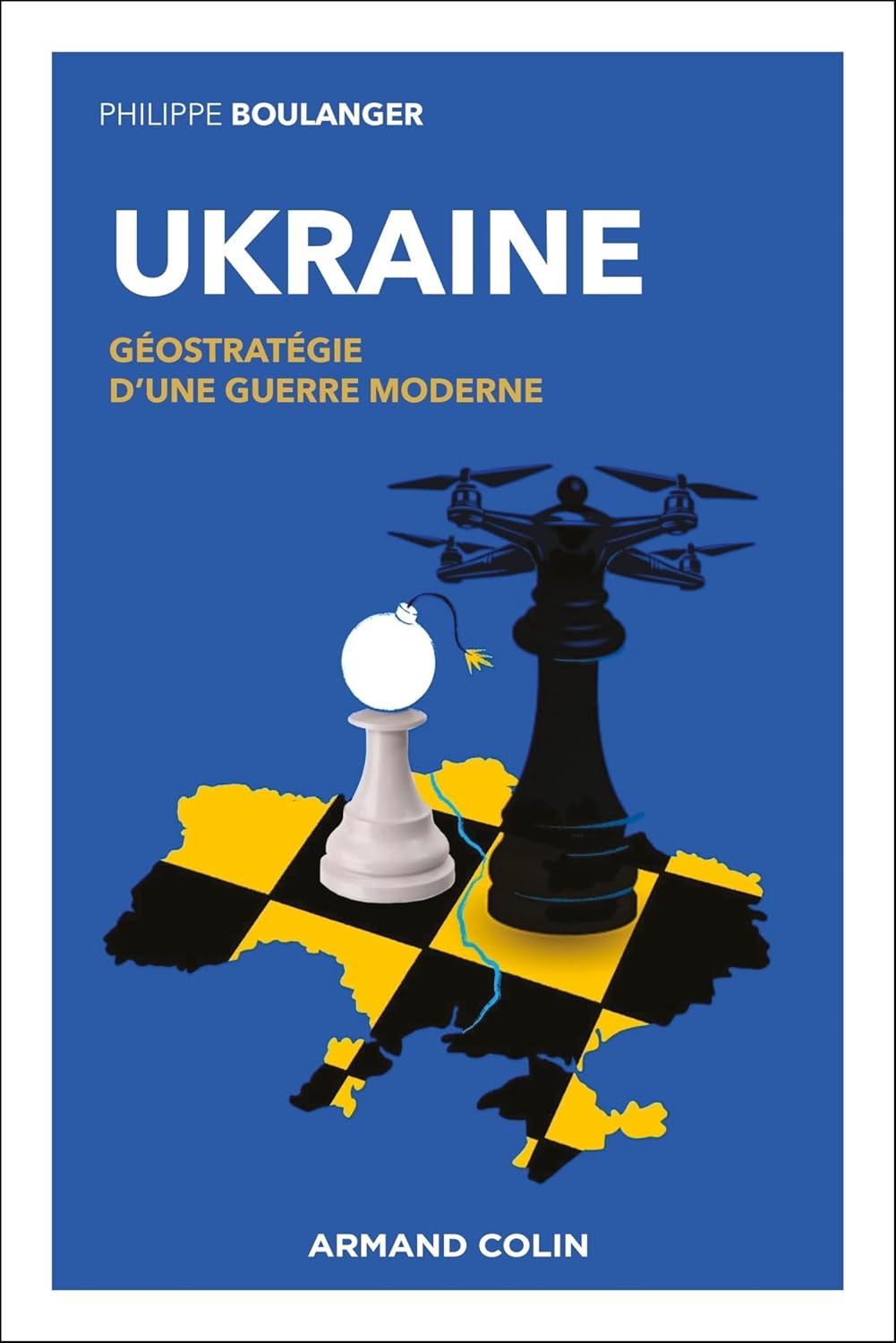
Un de nos meilleurs spécialistes de la géographie militaire et de la géostratégie, qu’il enseigne à Sorbonne-Université, livre une profonde synthèse, agrémentée de nombreuses cartes sur la guerre en Ukraine qu’il qualifie de « moderne ». Action d’acteurs militaires se déployant sur de grands espaces, ceux des continents ou des grands États, ce qui est le cas de l’Ukraine avec ses 603 000 km2, la géostratégie se démarque de la géotactique, action purement locale – comme le sont les destructions fréquentes de colonnes de chars ou de véhicules blindés, et de batteries ennemies – et de la géo-opérationnelle, cette dernière de dimension régionale, c’est-à-dire dans le cas ukrainien de l’oblast (région) ou d’une portion d’entre elles. Cette division se traduit par les échelles de dimensions différentes : 100 à 200 kilomètres pour l’échelon tactique, 200 à 500 km pour le niveau opérationnel, bien au-dessus de 500 km pour le stratégique. On trouvera donc dans cet ouvrage une analyse fouillée, de cette guerre conventionnelle de haute intensité qui intègre également les espaces immatériels (cyber, propagande, affrontements des représentations, désinformation, etc.), tous éléments parfaitement intégrés à la manœuvre stratégique globale. La guerre en Ukraine que tous les états-majors du monde décortiqueront durant des décennies offre un rare, sinon unique, exemple de guerre multi-milieux et multi-champs (M2MC ou MDO).
Historiquement, l’Ukraine, vaste espace quasiment démuni de montagnes, sauf au sud-ouest, avec une maigre portion des Carpates, qui a servi longtemps de zone tampon dépourvue de frontières naturelles, a toujours été convoitée pour ses ressources naturelles, ses terres agricoles parmi les plus riches du monde (tchernoziom) et sollicitée pour son rôle de bouclier territorialisé face à des ennemis ou envahisseurs réels ou potentiels. Dès le lancement de ce que Moscou appelle, l’« Opération militaire spéciale » (SVO), les objectifs de guerre au niveau stratégique consistent à prendre le contrôle des multiples centres de gravité en Ukraine, dont les nœuds logistiques et de communication font partie. « La destruction des voies ferrées interrompt la logistique, la destruction des ponts interrompt les opérations. » À peu de choses près – le transport routier a depuis bien secondé le ferroviaire pour l’approvisionnement –, les mots du maréchal allemand Helmuth von Moltke, prononcés en 1861, restent actuels pour le théâtre ukrainien : pas d’avancée sans franchissement de coupure humide. Ils ont visé, à partir des quatre axes d’invasion, de les occuper dans le dessein de renverser le gouvernement en limitant l’anéantissement des forces adverses. À ce jour, il semble que l’unanimité ne s’est pas faite sur les objectifs initiaux de Moscou. S’est-il agi avant tout de protéger la population russophone du Donbass, en exerçant une forte pression sur le gouvernement en s’en prenant directement à lui ? Ou hypothèse maximale, de se livrer à une guerre majeure d’invasion et de conquête totale du pays ? Ou encore, dernière éventualité, d’opérer un changement de régime, par une frappe initiale sur Kiyv, selon la doctrine classique russe de frappe initiale de décapitation, grâce à l’écrasement des troupes adverses ? Du fait de l’échec de cette phase, la Russie a dû changer de stratégie militaire dès mars 2022, tout en ne variant pas d’un pouce quant à ses objectifs politico-diplomatiques, d’où l’impasse actuelle des négociations à peine entamées.
Dans le contexte en vigueur, les affrontements visent les ressources énergétiques (centrales nucléaires, barrages, complexes électriques) dont on a vu l’intensité et les dangers. Un autre axe des batailles a porté sur les ports de la mer Noire, ceux qui constituent le poumon économique de l’Ukraine, par lesquels elle écoule ses exportations agricoles, une des principales sources de ses revenus. Pour la Russie, la mer Noire était aussi un enjeu de taille, car elle représentait avant la guerre 30 % du trafic des ports maritimes russes, soit 191 Mt de fret de janvier à septembre 2022.
Une troisième zone ou axe de combats a porté sur les grandes villes, Kiyv, Kharkiv, Marioupol ou les nœuds de communication (Kherson, Bakhmout, Avdiïvka, etc.). D’où, selon la tradition clausewitzienne les deux centres de gravité de cette guerre en Ukraine ou plus précisément de l’Ukraine en guerre, ce qui montre plus clairement la différence entre agresseur et agressé. Après avoir décrit les diverses phases de la guerre, au nombre de sept ou huit, que Philippe Boulanger ancre dans leur contexte géographique, mais aussi culturel, religieux, social et idéologique, il se livre à une description précise de la ligne de front longue d’un millier de kilomètres et large d’au moins 30 km. Il poursuit en présentant les différents bastions naturels, les forêts du Nord, le Donbass (4,4 % du territoire ukrainien mais 10 % de la population et 10 % de la production agricole ukrainienne) et le théâtre opérationnel de la mer Noire, autant de zones pivots.
Depuis 2024, les forces russes ont constamment cherché à opérer une rupture du front, sans avoir pu réaliser la percée décisive. En juin 2024, elles détenaient 17,52 % du territoire ukrainien, pourcentage passé à 18,30 % fin mars 2025, au prix de près d’un million de victimes. Cependant, il est vrai qu’aux yeux du pouvoir russe, ce n’est pas tant le territoire ou les victimes qui comptent, que l’importance géostratégique même de l’Ukraine qu’il convient de neutraliser ou mettre en tutelle. ♦








